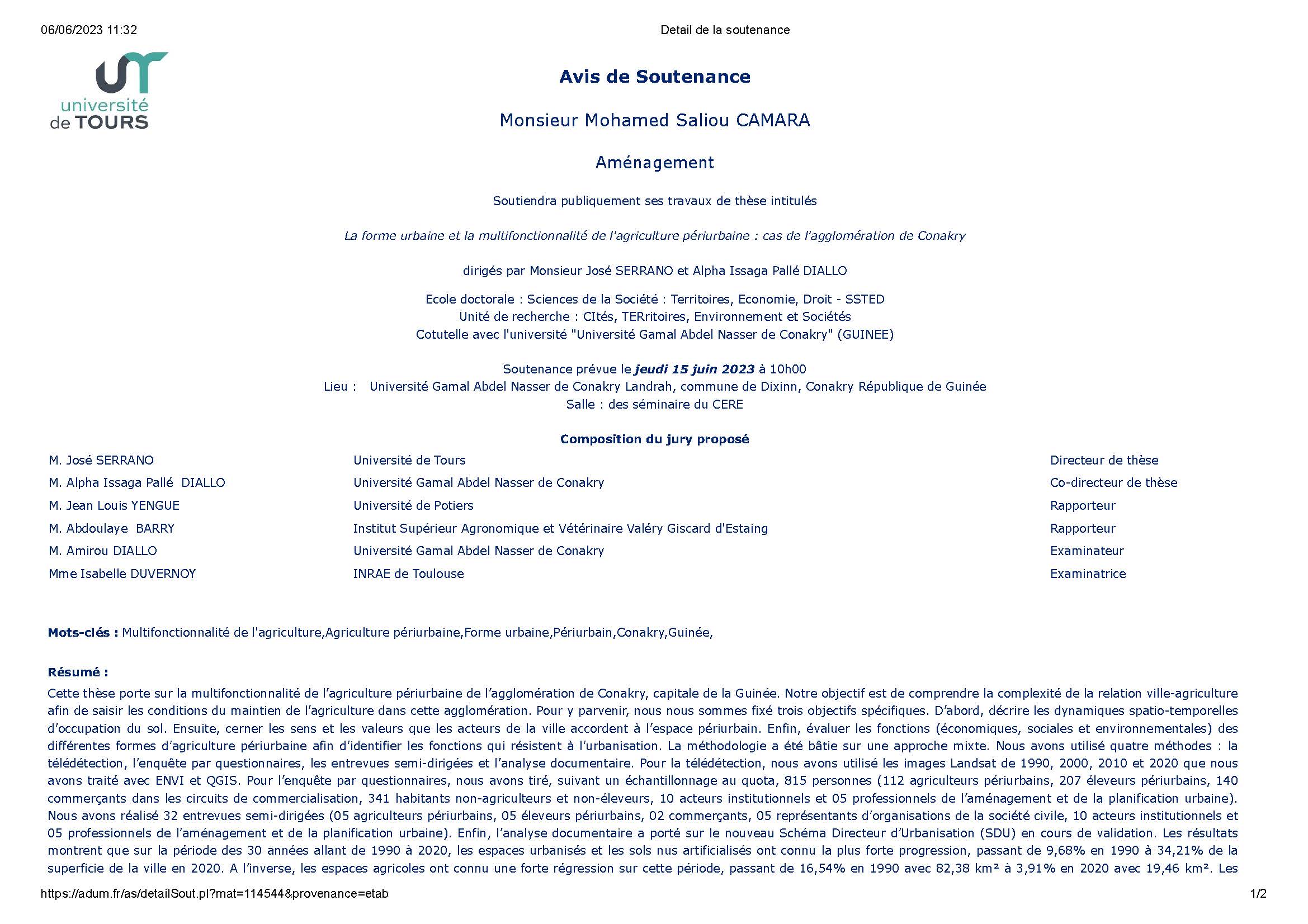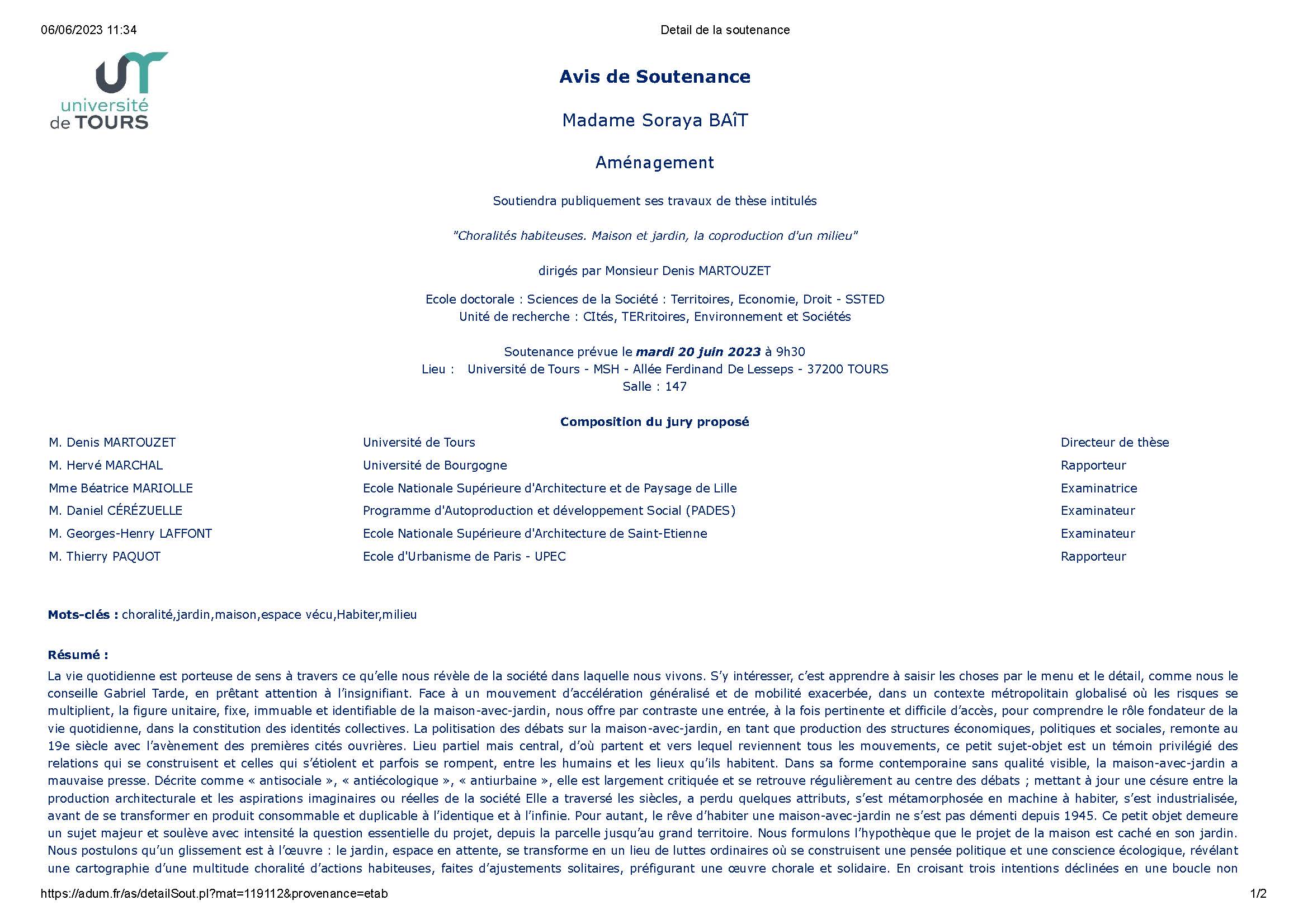DATE
Équipe Dynamique et Action Territoriales et Environnementales
Présentation de l’équipe Date
Responsable : Sylvie Servain
Co responsable équipe DATE : Nina Richard
L’organisation actuelle de l’équipe s’appuie sur la définition de 3 thématiques majeures, visant essentiellement à favoriser le travail collaboratif entre les chercheurs des sciences sociales et environnementales :
Axe 1 – Dynamiques environnementales, enjeux et paysages
Responsable : Sébastien Bonthoux
L’axe « dynamiques environnementales, enjeux et paysages » développe le regard croisé entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales.
Renforcement du couplage entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales
Quatre points constituent des pistes d’investigation : (i) le développement d’un regard d’écologie appliquée en interaction avec les besoins sociétaux ; (ii) l’émergence de l’écologie urbaine et des services écosystémiques culturels ; (iii) le développement des approches environnementales et socioculturelles des dynamiques du paysage et de ses représentations ; (iv) le confortement des travaux menés sur la Loire et les zones humides (écologie, restauration, patrimoine, paysage).
Le prisme d'analyse
Le prisme d’analyse retenu repose principalement sur la combinaison des approches géographiques et écologiques, appliquées au paysage et à l’environnement pour des objets communs comme les hydrosystèmes, les zones humides, les espaces urbains ou ruraux.
Les travaux à réaliser
Dans les travaux qui seront réalisés la notion de socio-écosystème sera mobilisée car particulièrement pertinente dans cet axe afin de conduire l’analyse des interactions entre les sociétés et les écosystèmes. Dans ce cadre, l’approche développée a pour spécificité de coupler les sciences écologiques et les sciences sociales en se basant sur la matérialité du territoire.
La mise en œuvre de l'axe
La mise en œuvre de l’axe proposé s’articule autour de thèmes connectés dont les objectifs spécifiques recoupent les questions, thématiques et approches évoquées précédemment.
Axe 2 – Risques, vulnérabilités et résilience des territoires
Responsables : Kamal Serrhini, José Serrano
L’inscription dans l’espace des questions environnementales (eau, air, énergie, transport, foncier…) est source de contraintes et de potentialités pour l’aménagement des territoires. Les injonctions nationales et internationales à l’éco-urbanisme, les attentes sociétales en matière de sécurité et l’appréhension de nouveaux enjeux par les décideurs locaux appellent des réponses scientifiques innovantes, dans une perspective analytique, mais aussi prospective et prescriptive. Cet axe développe une analyse systémique du fonctionnement des villes et des territoires, intégrant des données physiques mais aussi sociales et institutionnelles.
Interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l'ingénieur
L’interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l’ingénieur mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives et permet d’élargir les bases de la science des territoires.
Espaces de recherche spécifiques
Les recherches conduites au sein de l’axe s’attachent en particulier à des espaces vulnérables au regard de risques naturels, énergétiques ou soumis à des évolutions économiques ou démographiques défavorables.
Thèmes complémentaires de recherche
Les travaux exploreront deux thèmes complémentaires. Le premier concerne la vulnérabilité (versus la capacité de résilience) des réseaux et systèmes urbains. Le second thème concerne l’interdépendance entre des systèmes socio-environnementaux territoriaux dégradés et des schémas institutionnels, conflits et jeux coopératifs visant à favoriser leur résilience.
Axe 3 – Actions intentionnelles territorialisantes
Responsable : Laura Verdelli
L’axe actions intentionnelles territorialisantes poursuit la réflexion sur le projet d’aménagement en élargissant les notions de projet et de système d’action à toute action intentionnelle. Dans cette perspective, le projet est à considérer de façon extensive, du projet personnel se traduisant par des pratiques jusqu’au projet de société. Il sera analysé en tant qu’il a des conséquences en termes de territorialisation.
Questionnements scientifiques
Il découle de cela trois grandes séries de questionnements scientifiques : Qu’est-ce que le projet conçu ou appliqué, en tant qu’il a des répercussions sur le territoire ? Comment saisir les liens qu’entretiennent le projet et les pratiques socio-spatiales avec leurs contextes ? Quelles sont les conduites auxquelles incite le projet ou requises par celui-ci ?
Dimension juridique du projet
L’analyse du projet comprend la dimension juridique de celui-ci : le projet appliqué au territoire ou impactant le territoire correspond à la mise en œuvre de procédures. En quoi la procédure influence le déroulé et le contenu final du projet appliqué au territoire ?
Dimension sociologique du projet
La dimension sociologique du projet est aussi explorée. Le projet apparaît comme un système d’acteurs interagissant selon leurs représentations de l’espace, de la nature, des autres acteurs.
Observation des pratiques
L’observation des pratiques fait partie des objectifs de cet axe et dégager ce qui est de l’ordre de l’individuel et ce qui est de l’ordre du social en est un autre. La notion de pratique sera analysée, dans sa capacité à enclencher des processus de territorialisation, sous deux angles majeurs : les pratiques habitantes et les pratiques professionnelles.
Portée de l'axe
Cet axe a donc une portée descriptive et explicative, du côté du territoire (quels sont les processus ayant amené la situation actuelle ou passée ?) comme du côté des pratiques (quelles sont les répercussions de tels types de pratiques, de telles compositions de pratiques ?). Cet axe a aussi une portée opératoire : comment agir ou conduire à agir de manière à faire advenir tel processus de territorialisation ? Les résultats attendus sont une meilleure compréhension des modes de transformations des territoires.
Axe transversal – Adaptation aux changements globaux
Ce nouvel axe s’inscrit dans un des grands enjeux définis par le CNRS, dans un contexte de développement d’ambitions et de politiques publiques dédiées à différentes échelles, du local au global (COP21, loi biodiversité, Zéro artificialisation nette…). Cet axe intègre les enjeux du changement climatique, de la transition sociale et écologique, en intégrant la biodiversité.
Cet axe fait dialoguer les travaux menés dans les trois axes sur différents thèmes comme les risques naturels, l’adaptation des réseaux et du bâti, l’érosion de la biodiversité et permettra de développer des thèmes émergeants dont deux déjà identifiés sur le sol et la ressource en eau.
Retrouvez les ressources de l’équipe DATE
Annuaire de l’équipe DATE
Présentation de l’équipe Date
Responsable : Sylvie Servain
Co responsable équipe DATE : Nina Richard
L’organisation actuelle de l’équipe s’appuie sur la définition de 3 thématiques majeures, visant essentiellement à favoriser le travail collaboratif entre les chercheurs des sciences sociales et environnementales :
Axe 1 – Dynamiques environnementales, enjeux et paysages
Responsable : Sébastien Bonthoux
L’axe « dynamiques environnementales, enjeux et paysages » développe le regard croisé entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales.
Renforcement du couplage entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales
Quatre points constituent des pistes d’investigation : (i) le développement d’un regard d’écologie appliquée en interaction avec les besoins sociétaux ; (ii) l’émergence de l’écologie urbaine et des services écosystémiques culturels ; (iii) le développement des approches environnementales et socioculturelles des dynamiques du paysage et de ses représentations ; (iv) le confortement des travaux menés sur la Loire et les zones humides (écologie, restauration, patrimoine, paysage).
Le prisme d'analyse
Le prisme d’analyse retenu repose principalement sur la combinaison des approches géographiques et écologiques, appliquées au paysage et à l’environnement pour des objets communs comme les hydrosystèmes, les zones humides, les espaces urbains ou ruraux.
Les travaux à réaliser
Dans les travaux qui seront réalisés la notion de socio-écosystème sera mobilisée car particulièrement pertinente dans cet axe afin de conduire l’analyse des interactions entre les sociétés et les écosystèmes. Dans ce cadre, l’approche développée a pour spécificité de coupler les sciences écologiques et les sciences sociales en se basant sur la matérialité du territoire.
La mise en œuvre de l'axe
La mise en œuvre de l’axe proposé s’articule autour de thèmes connectés dont les objectifs spécifiques recoupent les questions, thématiques et approches évoquées précédemment.
Axe 2 – Risques, vulnérabilités et résilience des territoires
Responsables : Kamal Serrhini, José Serrano
L’inscription dans l’espace des questions environnementales (eau, air, énergie, transport, foncier…) est source de contraintes et de potentialités pour l’aménagement des territoires. Les injonctions nationales et internationales à l’éco-urbanisme, les attentes sociétales en matière de sécurité et l’appréhension de nouveaux enjeux par les décideurs locaux appellent des réponses scientifiques innovantes, dans une perspective analytique, mais aussi prospective et prescriptive. Cet axe développe une analyse systémique du fonctionnement des villes et des territoires, intégrant des données physiques mais aussi sociales et institutionnelles.
Interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l'ingénieur
L’interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l’ingénieur mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives et permet d’élargir les bases de la science des territoires.
Espaces de recherche spécifiques
Les recherches conduites au sein de l’axe s’attachent en particulier à des espaces vulnérables au regard de risques naturels, énergétiques ou soumis à des évolutions économiques ou démographiques défavorables.
Thèmes complémentaires de recherche
Les travaux exploreront deux thèmes complémentaires. Le premier concerne la vulnérabilité (versus la capacité de résilience) des réseaux et systèmes urbains. Le second thème concerne l’interdépendance entre des systèmes socio-environnementaux territoriaux dégradés et des schémas institutionnels, conflits et jeux coopératifs visant à favoriser leur résilience.
Axe 3 – Actions intentionnelles territorialisantes
Responsable : Laura Verdelli
L’axe actions intentionnelles territorialisantes poursuit la réflexion sur le projet d’aménagement en élargissant les notions de projet et de système d’action à toute action intentionnelle. Dans cette perspective, le projet est à considérer de façon extensive, du projet personnel se traduisant par des pratiques jusqu’au projet de société. Il sera analysé en tant qu’il a des conséquences en termes de territorialisation.
Questionnements scientifiques
Il découle de cela trois grandes séries de questionnements scientifiques : Qu’est-ce que le projet conçu ou appliqué, en tant qu’il a des répercussions sur le territoire ? Comment saisir les liens qu’entretiennent le projet et les pratiques socio-spatiales avec leurs contextes ? Quelles sont les conduites auxquelles incite le projet ou requises par celui-ci ?
Dimension juridique du projet
L’analyse du projet comprend la dimension juridique de celui-ci : le projet appliqué au territoire ou impactant le territoire correspond à la mise en œuvre de procédures. En quoi la procédure influence le déroulé et le contenu final du projet appliqué au territoire ?
Dimension sociologique du projet
La dimension sociologique du projet est aussi explorée. Le projet apparaît comme un système d’acteurs interagissant selon leurs représentations de l’espace, de la nature, des autres acteurs.
Observation des pratiques
L’observation des pratiques fait partie des objectifs de cet axe et dégager ce qui est de l’ordre de l’individuel et ce qui est de l’ordre du social en est un autre. La notion de pratique sera analysée, dans sa capacité à enclencher des processus de territorialisation, sous deux angles majeurs : les pratiques habitantes et les pratiques professionnelles.
Portée de l'axe
Cet axe a donc une portée descriptive et explicative, du côté du territoire (quels sont les processus ayant amené la situation actuelle ou passée ?) comme du côté des pratiques (quelles sont les répercussions de tels types de pratiques, de telles compositions de pratiques ?). Cet axe a aussi une portée opératoire : comment agir ou conduire à agir de manière à faire advenir tel processus de territorialisation ? Les résultats attendus sont une meilleure compréhension des modes de transformations des territoires.
Axe transversal – Adaptation aux changements globaux
Ce nouvel axe s’inscrit dans un des grands enjeux définis par le CNRS, dans un contexte de développement d’ambitions et de politiques publiques dédiées à différentes échelles, du local au global (COP21, loi biodiversité, Zéro artificialisation nette…). Cet axe intègre les enjeux du changement climatique, de la transition sociale et écologique, en intégrant la biodiversité.
Cet axe fait dialoguer les travaux menés dans les trois axes sur différents thèmes comme les risques naturels, l’adaptation des réseaux et du bâti, l’érosion de la biodiversité et permettra de développer des thèmes émergeants dont deux déjà identifiés sur le sol et la ressource en eau.
Retrouvez les ressources de l’équipe DATE
Suivez les actualités de l’équipe DATE
Table ronde « Des métropoles et leur fleuve : Regards croisés Tours-‐Québec »
Samedi 16 juin 2018, 16h45, la Guinguette de Tours sur Loire Animée par des chercheurs de Tours et de Québec…
Présentation de l’équipe Date
Responsable : Sylvie Servain
Co responsable équipe DATE : Nina Richard
L’organisation actuelle de l’équipe s’appuie sur la définition de 3 thématiques majeures, visant essentiellement à favoriser le travail collaboratif entre les chercheurs des sciences sociales et environnementales :
Axe 1 – Dynamiques environnementales, enjeux et paysages
Responsable : Sébastien Bonthoux
L’axe « dynamiques environnementales, enjeux et paysages » développe le regard croisé entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales.
Renforcement du couplage entre les sciences écologiques et les sciences sociales et territoriales
Quatre points constituent des pistes d’investigation : (i) le développement d’un regard d’écologie appliquée en interaction avec les besoins sociétaux ; (ii) l’émergence de l’écologie urbaine et des services écosystémiques culturels ; (iii) le développement des approches environnementales et socioculturelles des dynamiques du paysage et de ses représentations ; (iv) le confortement des travaux menés sur la Loire et les zones humides (écologie, restauration, patrimoine, paysage).
Le prisme d'analyse
Le prisme d’analyse retenu repose principalement sur la combinaison des approches géographiques et écologiques, appliquées au paysage et à l’environnement pour des objets communs comme les hydrosystèmes, les zones humides, les espaces urbains ou ruraux.
Les travaux à réaliser
Dans les travaux qui seront réalisés la notion de socio-écosystème sera mobilisée car particulièrement pertinente dans cet axe afin de conduire l’analyse des interactions entre les sociétés et les écosystèmes. Dans ce cadre, l’approche développée a pour spécificité de coupler les sciences écologiques et les sciences sociales en se basant sur la matérialité du territoire.
La mise en œuvre de l'axe
La mise en œuvre de l’axe proposé s’articule autour de thèmes connectés dont les objectifs spécifiques recoupent les questions, thématiques et approches évoquées précédemment.
Axe 2 – Risques, vulnérabilités et résilience des territoires
Responsables : Kamal Serrhini, José Serrano
L’inscription dans l’espace des questions environnementales (eau, air, énergie, transport, foncier…) est source de contraintes et de potentialités pour l’aménagement des territoires. Les injonctions nationales et internationales à l’éco-urbanisme, les attentes sociétales en matière de sécurité et l’appréhension de nouveaux enjeux par les décideurs locaux appellent des réponses scientifiques innovantes, dans une perspective analytique, mais aussi prospective et prescriptive. Cet axe développe une analyse systémique du fonctionnement des villes et des territoires, intégrant des données physiques mais aussi sociales et institutionnelles.
Interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l'ingénieur
L’interdisciplinarité entre les sciences sociales et les sciences et techniques de l’ingénieur mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives et permet d’élargir les bases de la science des territoires.
Espaces de recherche spécifiques
Les recherches conduites au sein de l’axe s’attachent en particulier à des espaces vulnérables au regard de risques naturels, énergétiques ou soumis à des évolutions économiques ou démographiques défavorables.
Thèmes complémentaires de recherche
Les travaux exploreront deux thèmes complémentaires. Le premier concerne la vulnérabilité (versus la capacité de résilience) des réseaux et systèmes urbains. Le second thème concerne l’interdépendance entre des systèmes socio-environnementaux territoriaux dégradés et des schémas institutionnels, conflits et jeux coopératifs visant à favoriser leur résilience.
Axe 3 – Actions intentionnelles territorialisantes
Responsable : Laura Verdelli
L’axe actions intentionnelles territorialisantes poursuit la réflexion sur le projet d’aménagement en élargissant les notions de projet et de système d’action à toute action intentionnelle. Dans cette perspective, le projet est à considérer de façon extensive, du projet personnel se traduisant par des pratiques jusqu’au projet de société. Il sera analysé en tant qu’il a des conséquences en termes de territorialisation.
Questionnements scientifiques
Il découle de cela trois grandes séries de questionnements scientifiques : Qu’est-ce que le projet conçu ou appliqué, en tant qu’il a des répercussions sur le territoire ? Comment saisir les liens qu’entretiennent le projet et les pratiques socio-spatiales avec leurs contextes ? Quelles sont les conduites auxquelles incite le projet ou requises par celui-ci ?
Dimension juridique du projet
L’analyse du projet comprend la dimension juridique de celui-ci : le projet appliqué au territoire ou impactant le territoire correspond à la mise en œuvre de procédures. En quoi la procédure influence le déroulé et le contenu final du projet appliqué au territoire ?
Dimension sociologique du projet
La dimension sociologique du projet est aussi explorée. Le projet apparaît comme un système d’acteurs interagissant selon leurs représentations de l’espace, de la nature, des autres acteurs.
Observation des pratiques
L’observation des pratiques fait partie des objectifs de cet axe et dégager ce qui est de l’ordre de l’individuel et ce qui est de l’ordre du social en est un autre. La notion de pratique sera analysée, dans sa capacité à enclencher des processus de territorialisation, sous deux angles majeurs : les pratiques habitantes et les pratiques professionnelles.
Portée de l'axe
Cet axe a donc une portée descriptive et explicative, du côté du territoire (quels sont les processus ayant amené la situation actuelle ou passée ?) comme du côté des pratiques (quelles sont les répercussions de tels types de pratiques, de telles compositions de pratiques ?). Cet axe a aussi une portée opératoire : comment agir ou conduire à agir de manière à faire advenir tel processus de territorialisation ? Les résultats attendus sont une meilleure compréhension des modes de transformations des territoires.
Axe transversal – Adaptation aux changements globaux
Ce nouvel axe s’inscrit dans un des grands enjeux définis par le CNRS, dans un contexte de développement d’ambitions et de politiques publiques dédiées à différentes échelles, du local au global (COP21, loi biodiversité, Zéro artificialisation nette…). Cet axe intègre les enjeux du changement climatique, de la transition sociale et écologique, en intégrant la biodiversité.
Cet axe fait dialoguer les travaux menés dans les trois axes sur différents thèmes comme les risques naturels, l’adaptation des réseaux et du bâti, l’érosion de la biodiversité et permettra de développer des thèmes émergeants dont deux déjà identifiés sur le sol et la ressource en eau.
Retrouvez les ressources de l’équipe DATE
Suivez les actualités de l’équipe DATE
Soutenance de thèse de Mohamed Saliou Camara « La forme urbaine et la multifonctionnalité de l’agriculture périurbaine : cas de l’agglomération de Conakry »
jeudi 15 juin 2023 à 10h00 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry Landrah, commune de Dixinn, Conakry République de Guinée…
Soutenance de thèse de Soraya Baït « Choralités habiteuses. Maison et jardin, la coproduction d’un milieu »
Mardi 20 juin 2023, 9h30 MSH – Allée Ferdinand De Lesseps – 37200 TOURS Salle 147 Composition du jury proposé…
Soutenance de thèse de Youness Achmani « Le projet urbain au prisme de la justice spatiale et du paradigme de la ville juste : des des gagnants et des perdants. Cas des projets d’aménagement de la Vallée de Bouregreg (Rabat-Maroc) et de Saint- Sauveur (Lille-France) »
Mardi 20 juin 2023, 14h00, Université de Tours – 33-35 allée Ferdinand de Lesseps, 37200 TOURS Salle : 204 …
Soutenance de thèse de Mohammad Thaher
Vendredi 23 juin 2023, 10h00, Université de Tours – Département Aménagement et Environnement de Polytech’Tours – 35 allée Ferdinand de…